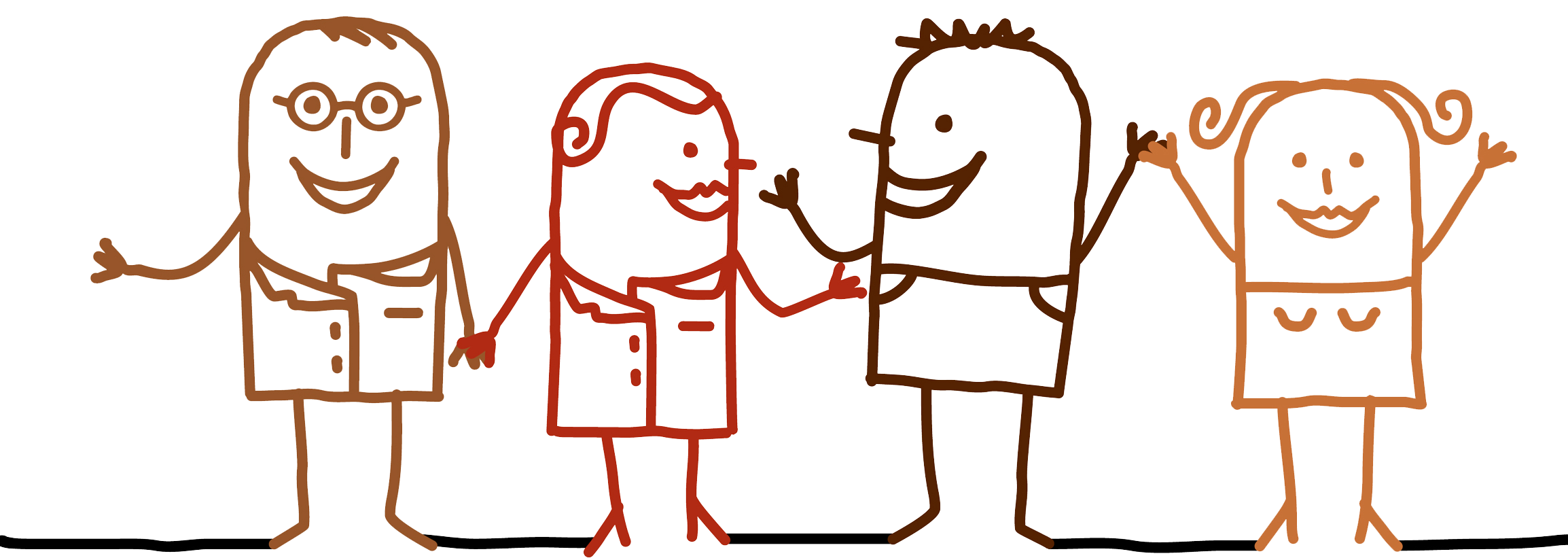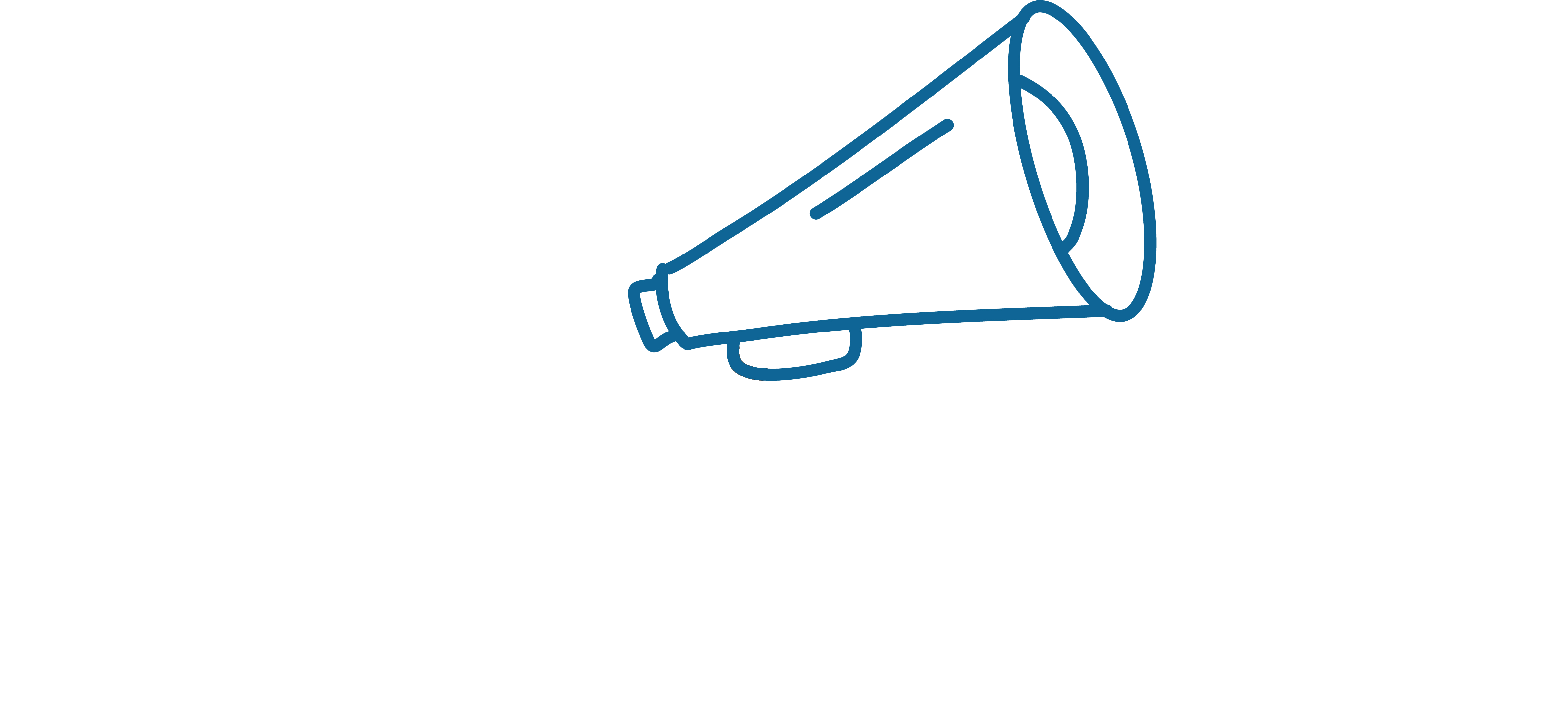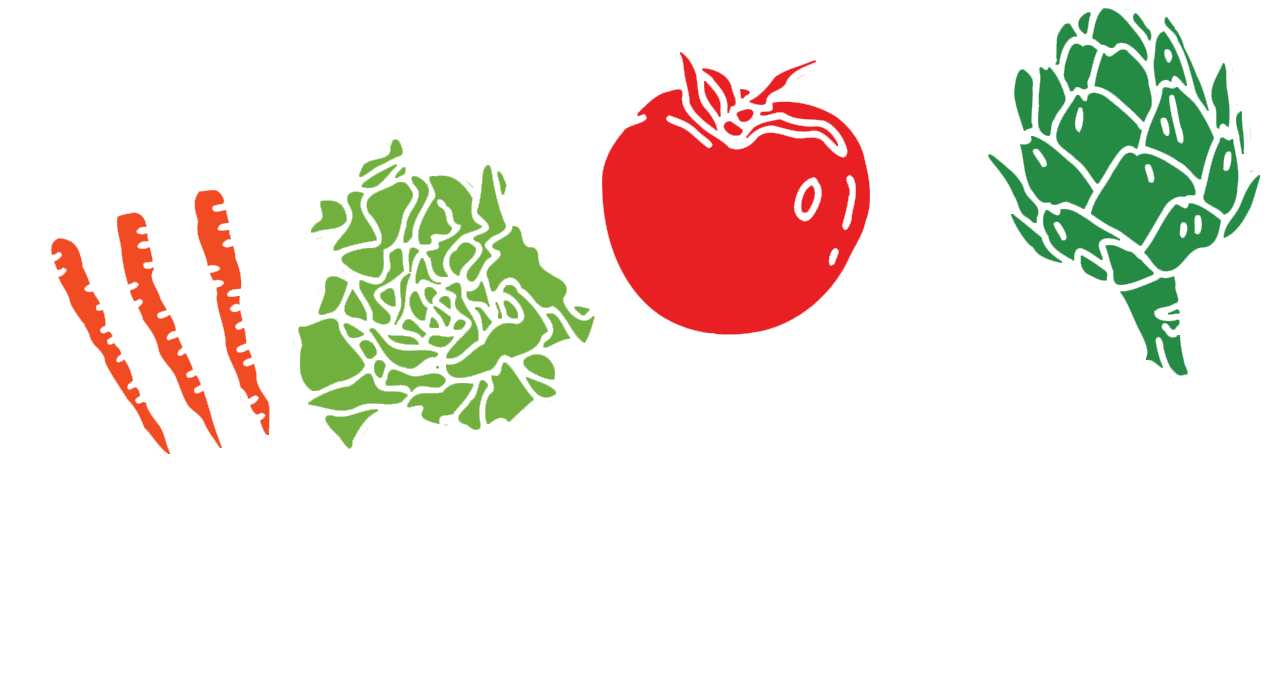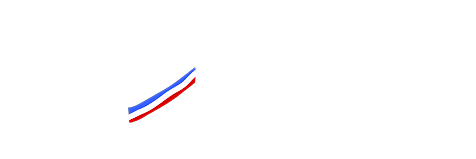Colloque 2014 : L’éducation thérapeutique, un vrai levier – Docteur Patrick Jourdain
Palais Bourbon – Salle Colbert – 20 Novembre 2014

Organiser toute une journée autour de l’éducation thérapeutique est une excellente initiative. Je vous rappelle que l’éducation thérapeutique, c’est acquérir et conserver les capacités et surtout les compétences. L’idée n’est pas juste de savoir mais de mettre en oeuvre pour vivre de manière optimale avec sa maladie. L’idée est de se reconstruire. C’est un processus permanent, qui ne s’arrête pas à la porte de l’hôpital.
En fait, l’éducation thérapeutique, ce n’est pas que de la sympathie et de l’empathie. On peut être très sympathique sans être à l’écoute du patient. Ce n’est pas que de l’information qui est uniquement descendante : « Faites ceci, faites cela. »
En pratique, ce qu’il faut retenir, c’est que l’éducation thérapeutique est une démarche continue. On élabore un diagnostic, comme dans tout acte de soin. Si on ne sait pas à qui on s’adresse, on ne s’adaptera pas. Quand le médecin ou le soignant va voir un patient, il doit savoir à qui il s’adresse. On ne parlera pas de la même manière à Mme X qu’à M. Y, parce que l’on aura fait un mini-diagnostic éducatif. Il faut ensuite mettre en place un programme personnalisé (c’est pour cela qu’il n’y a jamais de programme standard) et surtout, évaluer les compétences et là je me base sur les recommandations de la Haute Autorité de santé qui, dès 2007, a mis en avant l’intérêt de l’éducation thérapeutique pour la prise en charge du patient.
Cet acte de diagnostic est tout simple. Il est centré sur le patient : « Qu’a-t‑il ? Que fait-il ? Que sait-il ? Qui est-il ? Comment accepte-t‑il la maladie ? » Et surtout : « Quels sont ses projets ? », « Est-il en train de se reconstruire ou est-il encore brisé par la maladie ? » Et on sait que ce ne sera pas du tout la même approche. Et souvent, on se dit que certaines conceptions du patient sont un obstacle à une bonne réactivité.
En fait, l’éducation peut reposer sur des méthodes pédagogiques différentes. La question n’est pas la méthode, c’est la façon dont on la met en oeuvre et la faculté d’adaptation à tout patient. Cela doit être centré sur l’apprentissage et la réactivité.
Dès 2007, la Société française de cardiologie a mis en place un programme pour des insuffisants cardiaques qui a permis d’aider clairement le patient à se prendre en charge. L’idée est de dire au patient de manière simple qu’il peut lui-même détecter de façon précoce ses signes cliniques et déterminer s’il doit consulter.
La consultation ne se termine pas par une prescription mais par une contractualisation, on décide ensemble : « Que vous sentez-vous capable de faire dans ce qui est préconisé ? » Parfois, la réponse est juste : « Prendre le traitement, me faire suivre ». Puis au fur et à mesure, on va affiner avec un contrat spécifique. Il ne faut pas dire : « Faites tout bien demain », cela ne marchera jamais. Par contre, dire : « Peut-être que l’effort, chez vous, va être de manger un peu moins de sel » ou « Peut-être que l’effort sera de diminuer votre consommation de tabac », « Peut-être que l’effort va être de bien prendre le traitement ».
Le traitement n’est pris de façon optimale que par à peine 60 % des patients. À un mois de l’infarctus, seulement un tiers des patients prendra correctement son traitement. Nous en sommes là parce que le patient n’est pas forcément convaincu, et que prendre des médicaments n’est jamais naturel.
On va impliquer les proches et les aidants du patient, à condition qu’ils restent aidants. Ils ne doivent pas faire à sa place.
Parlons de l’insuffisance cardiaque, qui touche 2 % de la population et représente 1 750 000 journées d’hospitalisation par an, dont 30 % évitables par une bonne prise en charge. Et un taux de réhospitalisation très élevé, un pronostic sombre. Après les différents types de cancers, chez la femme ou chez l’homme, et à part le cancer du poumon, la maladie la plus sévère, c’est l’insuffisance cardiaque. Le coût de la maladie est extrêmement important et 60 % sont des coûts d’hospitalisation. On pensait que la technique avait tout réglé, on était tout content parce que l’on avait plein d’indicateurs, des supers avions, sauf que parfois on perd le cap. Je vous l’ai dit, la prescription est un fait, le fait de prendre le traitement, c’est autre chose. Et quand on ne prend pas une classe thérapeutique prescrite, le risque de décès est multiplié par 3,80. Vous imaginez, on parle d’une baisse de livret A de 0,25 %, là on parle de 3,80 %.
Dans tous les pays du monde, vous diminuez les durées de séjour à l’hôpital quand vous faites de l’éducation thérapeutique pour les insuffisants cardiaques.
Vous prenez des patients de plus de 55 ans pour des études randomisées, c’est-à-dire par tirage au sort sur plus de 3 000 patients ;
il suffit de former 12 patients (j’en vois 18 par consultation) pour éviter une hospitalisation dans l’année.
Regardons les chiffres de la mortalité toutes causes confondues : quand vous êtes éduqué, votre mortalité est en gros de 16 % à deux ans, quand vous n’êtes pas éduqué, c’est 26 %. L’éducation, et non l’information, améliore la qualité de vie, le suivi, diminue les coûts, les risques et la mortalité, et cela de façon variable dans les pathologies. Chez nous, le taux de réhospitalisation a été divisé par deux en dix ans. Et pourtant, en France, seuls 5 % des insuffisants cardiaques sont formés actuellement : 5 %, on est très bas. Reconnaître l’éducation thérapeutique en tant qu’acte de santé, en contrepartie d’un agrément ARS[1], et la rendre obligatoire dans l’enseignement en faculté de médecine, voilà un bon projet. Actuellement, moins de 10 % des facultés de médecine ont un enseignement en éducation thérapeutique, alors que cela fait partie de la base de l’enseignement infirmier. Cela ne coûtera pas grand-chose de le mettre en place, et cela changera la philosophie de l’éducation.
Parmi les autres projets pertinents :
- financer l’éducation dans les pathologies où elle a démontré un impact, parce que l’on est dans un moment contraint où chaque sou versé doit être un sou utile ;
- mettre en oeuvre une politique d’évaluation standardisée, en lien avec les sociétés savantes, parce que si nous ne remportons pas cette bataille de l’éducation thérapeutique, on dépensera toujours plus pour un effet plus limité ;
- il nous faut une réponse institutionnelle, il faut des arbitrages. Parce que ne soigner que l’aigu, sans faire d’éducation, cela donne ce qui se passe au Canada : vous avez les urgences, l’unité débordement, puis le parking !
Mme Anne-Sophie JOLY
Concernant l’obésité, le ministère de la Santé ainsi que les ARS se basent sur l’expérience et la prise en charge des associations, en se rendant compte que nous sommes les plus proches, et peut-être les plus légitimes, à faire de l’éducation thérapeutique avec les patients. Nous avons des outils que l’on co-organise avec des laboratoires. Ces laboratoires nous donnent des moyens financiers que l’État ne nous donne pas.
Docteur Patrick JOURDAIN
Dans l’éducation thérapeutique et l’obésité, il y a une orientation vers les associations de patients, et la mise en place d’outils pour l’éducation du patient. Les associations font du bon travail d’équipe et sont proches du patient.
[1] Agence régionale de santé.
RETOUR EN HAUT DE PAGE
voir tous les articles de la catégorie