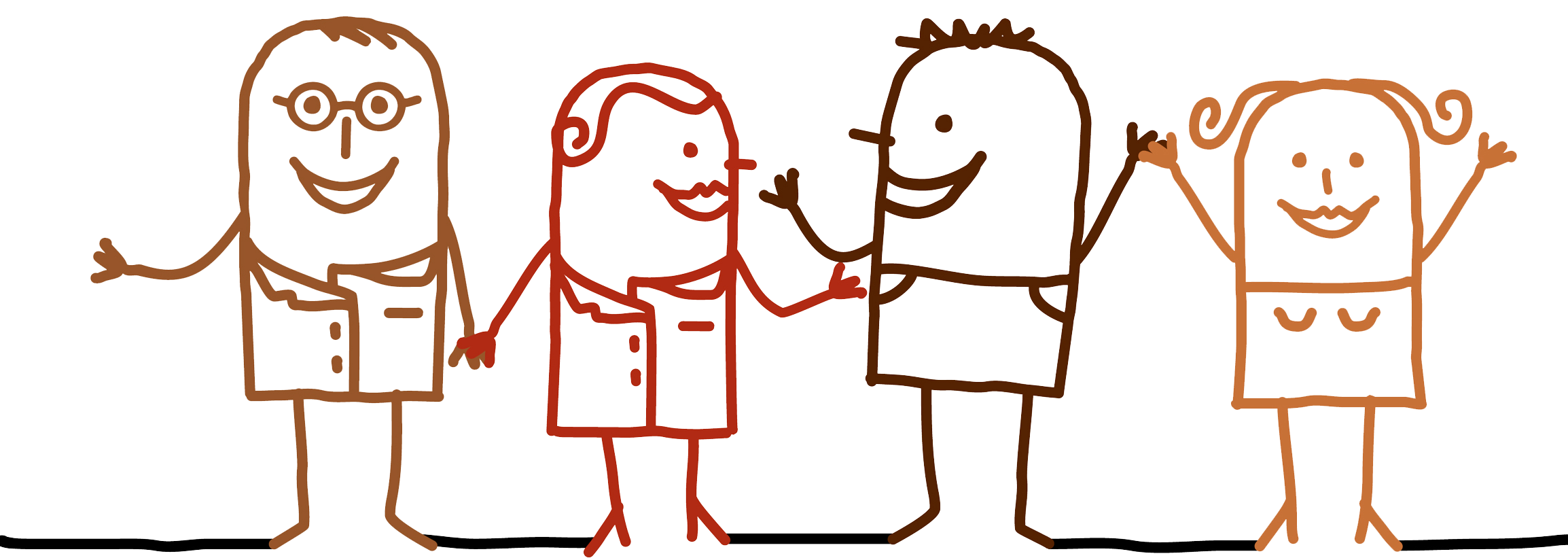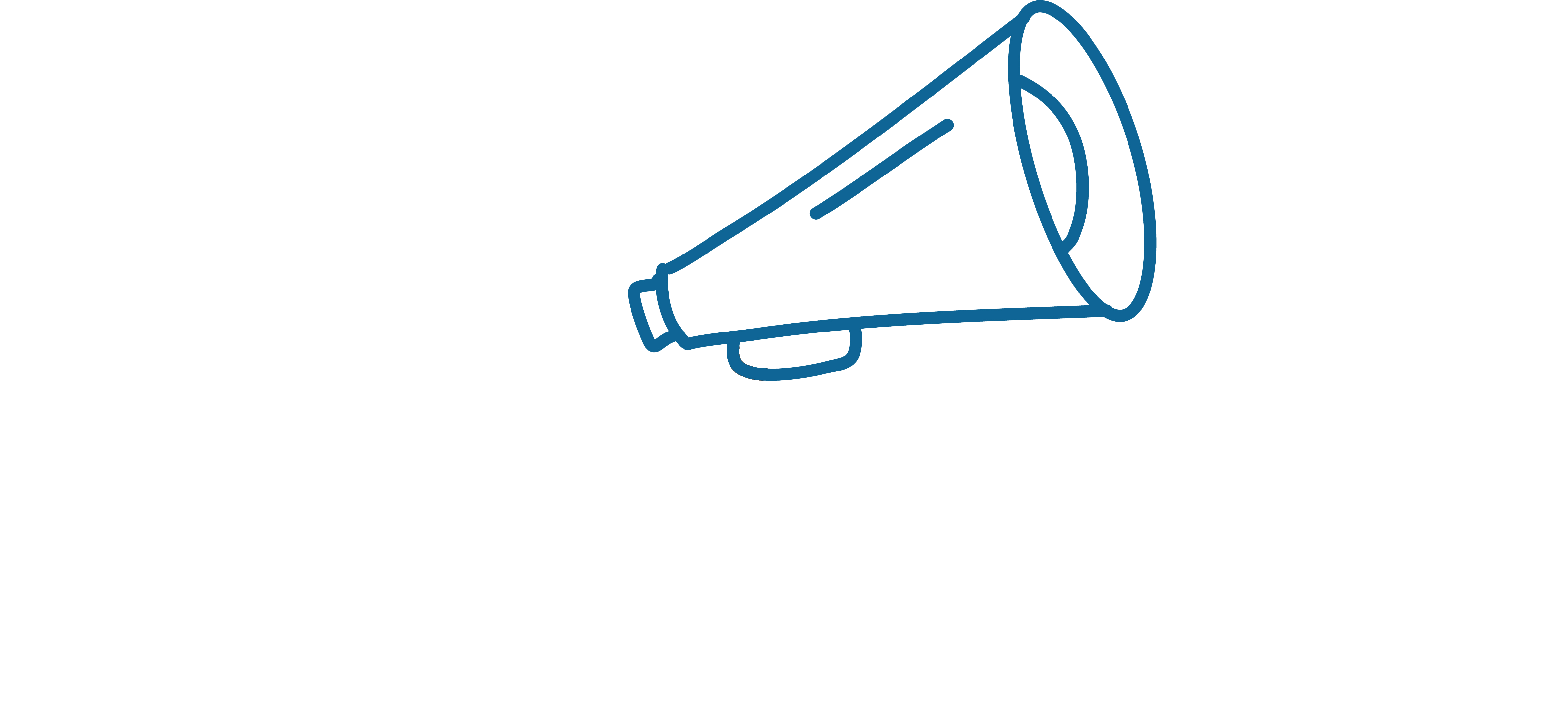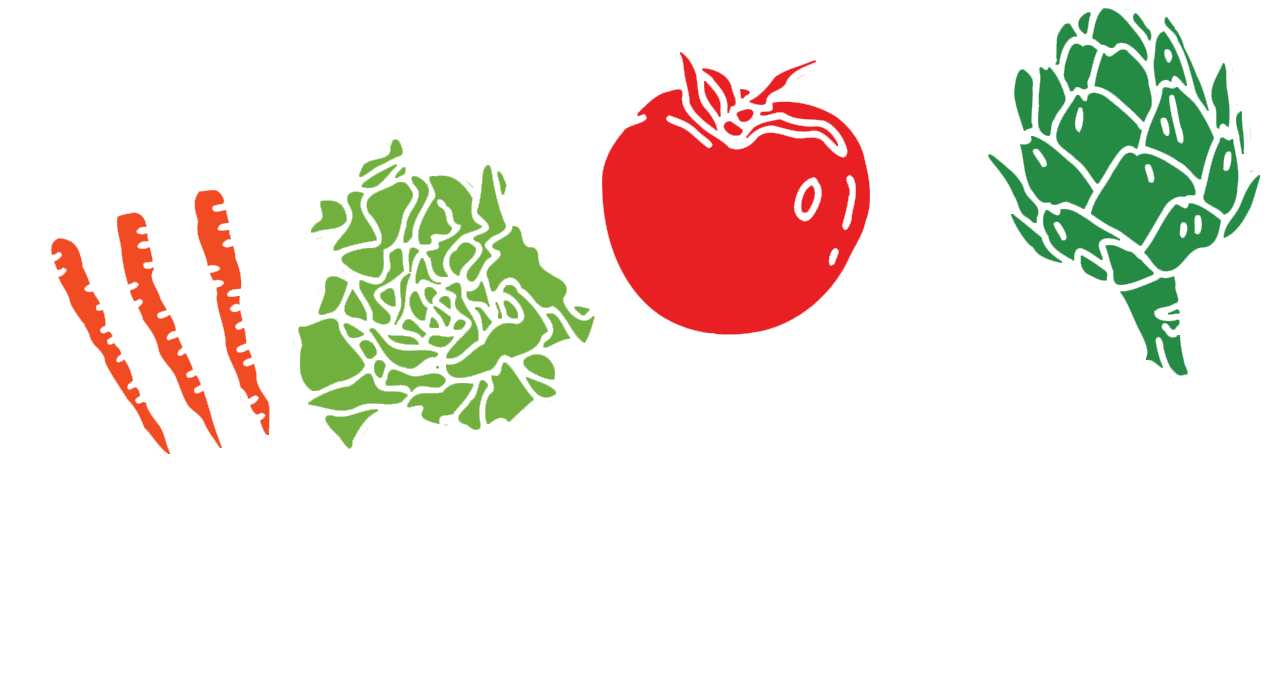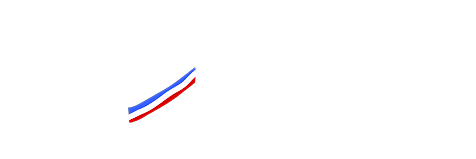Colloque 2014 : Patient, acteur de sa santé – Docteur Jean-François Thébaut
Palais Bourbon – Salle Colbert – 20 Novembre 2014
Je suis aussi cardiologue. Je m’exprime au nom de la Haute Autorité de santé, et ce ne sont bien sûr pas des opinions personnelles que je vais vous transmettre. La Haute Autorité de santé est une autorité à caractère scientifique indépendante. Elle aide les dirigeants à prendre des décisions. Elle a aussi pour mission d’aider l’usager et de le guider dans le système de soin, à partir d’un certain nombre de missions d’informations. Ces missions peuvent être l’édition de recommandations, de documents pour les patients ou bien l’information des usagers sur le système de santé et plus particulièrement sur les établissements hospitaliers. Un site, Scop santé[1], a été mis en ligne. Il vous permet de trouver tous les indicateurs concernant la qualité des établissements de santé. La Haute Autorité de santé est centrée sur le patient et sur les soins. Le patient, pour être réellement acteur de sa santé, doit être en mesure de répondre à un certain nombre de questions : « Les soins qu’on m’a proposés sont-ils nécessaires, suffisants pour mon état de santé ? Étaient-ils réellement utiles ? Y avait-il une alternative possible à ce traitement ? Cela a-t‑il été bénéfique ? Y avait-il des risques ? Ai-je vraiment participé à la décision ? Ai-je été suffisamment informé sur le diagnostic de ma maladie, son évolution, les risques et la conduite à tenir ? »
Ce sont toutes ces questions qui vont être traitées entre le médecin et le malade.
Dans ce cadre, la Haute Autorité de santé s’est interrogée : de quels types d’informations le patient a- ‑il besoin ? Dans quel contexte les lui donne-t‑on ?
Plusieurs modèles de réponses peuvent être proposés. Depuis Hippocrate, on n’a pas beaucoup changé, même si le serment d’Hippocrate a été modifié en 1996 de manière assez officielle.
En Europe, on est passé progressivement d’un modèle dit « paternaliste », où le médecin savait tout et disait à son patient ce qu’il fallait faire, à un modèle « délibératif », dans lequel on essaye de décider avec lui. Aux États-Unis, on est plus dans une décision dite « informée » c’est-à-dire que le médecin donne tous les éléments au patient et lui dit : « C’est à vous de choisir. » L’information du patient aux États-Unis est indispensable pour dégager en partie le médecin d’une éventuelle responsabilité dans la thérapie, alors qu’en France l’information que l’on a donnée au patient ne dégage pas pour autant le soignant de sa responsabilité. Il en est ainsi du consentement éclairé que reçoit le patient, le fait qu’il le signe ou pas n’a aucune valeur juridique.
Un autre modèle auquel nous avons fait allusion tout à l’heure est le modèle d’agence. Le patient va donner toutes ses préférences et le médecin décidera pour lui, non pas en fonction de ce que lui pense être bien, mais en fonction des préférences du patient. Dernier élément : ne pas méconnaître le fait que les patients ont le droit de ne pas savoir. On le verra, dans un certain nombre d’études, 25 % des patients en France, en Europe, souhaitent ne pas savoir.
Les différentes recommandations de la Haute Autorité de santé ont maintenant plus d’une quinzaine d’années. Elles ont soulevé de nombreuses questions d’éthique.
Les principes fondamentaux de l’éthique médicale sont la bienfaisance, la non-malfaisance, l’autonomie des patients et la justice sociale. Une grille d’analyse permet de voir si, pour chacun des cas, la recommandation faite va pouvoir répondre à ces interrogations éthiques.
La Haute Autorité de santé fait des recommandations médicales avec des preuves scientifiques. Certes, le patient peut faire lui-même son diagnostic sur Internet, son choix thérapeutique, mais à un moment il y aura forcément un colloque singulier avec un médecin – sauf s’il achète aussi ses médicaments sur Internet à l’étranger –, et à cette occasion-là, au cours de cet échange, seront prises des décisions, thérapeutiques, diagnostiques partagées.
Le patient a le droit de savoir et de décider, au même titre que le médecin, à condition d’avoir été informé, non pas selon les opinions du médecin, mais selon des preuves scientifiques. Tous les éléments et documents que l’on va être amené à fournir au patient doivent absolument reposer sur des recommandations de haut niveau de preuves, afin de pouvoir conseiller le patient de manière éclairée.
De la même manière, les risques inhérents aux actes, aux traitements et aux actes diagnostiques que l’on va lui proposer doivent être clairement explicités, de manière qu’il n’y ait pas de « malfaisance », de « iatrogénie », que le patient puisse bénéficier du rapport bénéfice-risque qu’on lui propose, et des différentes solutions. Enfin, cela doit se faire en toute conscience et autonomie du patient, et dans le cas présent, information, consentement éclairé, partage de la décision sont les principes qui permettent de respecter l’autonomie du patient.
Dernier point, celui de la justice sociale. Nous sommes dans un contexte, en France, en Europe, et de plus en plus dans le monde entier, dans lequel seuls des actes utiles doivent être pratiqués, pour deux raisons : un acte inutile peut entraîner de l’iatrogénie, première chose. Deuxième chose, un acte inutile coûte à la collectivité. Tout acte inutile est potentiellement quelque chose que l’on retire à quelqu’un d’autre, on a longuement parlé des déficits. Il est donc absolument fondamental que le patient, qui participe à la discussion, soit conscient de ces éléments. Cela ne veut pas dire que l’on ne doive pas faire tout ce qui est nécessaire pour le patient, simplement ne pas faire ce qui est inutile, d’autant plus que cela entraîne toujours de l’iatrogénie, en dehors de ce qui ne sert à rien et qui n’est donc pas dangereux.
J’ai repris tous les travaux faits au sein de la Haute Autorité de santé, en matière de recommandation, hors champ de la prévention primaire. Elle n’est pas dans le champ de la Haute Autorité de santé, sauf pour les sujets très particuliers que sont les prérogatives de l’INPES. Le travail initial a été fait en 2000 par l’ANAES [2]– la Haute Autorité de santé n’existait pas à l’époque –qui a rendu un premier document princeps, avec des recommandations pour les documents d’informations remis au patient.
Ensuite, en 2008, le travail a été repris pour faire des recommandations sur la manière d’élaborer des brochures d’informations pour les patients et pour les usagers. C’est absolument fondamental, dans cette décision partagée, dans cette information avec le patient, de pouvoir lui donner des documents auxquels il va se référer. On ne peut pas imaginer qu’une simple discussion permette au patient, en un quart d’heure, une demi-heure de consultation, d’assimiler tous les éléments. Il faut qu’il y ait une base documentaire. Maintenant, elle peut se trouver sur Internet. À l’époque, c’était essentiellement sur papier, mais, bien entendu, tous les supports sont possibles, et si je ne parle pas du numérique, il retrouvera sa place chaque fois, automatiquement.
Une autre recommandation qui a été faite concerne la délivrance de l’information à la personne sur son état de santé, notamment dans le cadre des maladies chroniques, avec toutes les recommandations d’annonces qui ont conduit, en particulier pour la cancérologie, à l’établissement du diagnostic d’annonce et un certain nombre d’éléments comme cela.
Le dernier élément qui est sorti : on a fait un état des lieux avec, très vraisemblablement dans la suite, une recommandation qui sortira sur les principes de la décision médicale partagée. Cela nous paraît l’aboutissement de la procédure. Il faut informer le patient, pour qu’il puisse partager la décision avec les professionnels qui s’occupent de lui. Bien entendu, cela ne concerne pas seulement les médecins. Cela concerne tous les professionnels qui sont amenés à proposer une séquence thérapeutique ou diagnostique au patient. En outre, bien entendu, l’éducation thérapeutique et les suivis d’indicateurs de qualité de santé ont été traités dans d’autres recommandations.
La France est le premier pays à avoir mis en place une législation sur l’information du patient (loi du 4 mars 2002). Et pourtant, nous sommes le pays où les patients se sentent le moins bien informés. Parlons du Commonwealth fund. Il s’agit d’une organisation internationale à laquelle participent, pour la France, l’Assurance maladie et la Haute Autorité de santé, qui fait des enquêtes dans onze pays. Il fait la même enquête dans ces onze pays et les répète régulièrement : en 2008, en 2011, en 2005 et maintenant en 2014. Il pose toujours les mêmes questions : cela permet de classer les pays en fonction du ressenti des patients. Ces questions sont posées tantôt aux patients une année, tantôt aux professionnels. La France est le pays le plus mal placé – je ne dis pas que c’est l’exactitude –, quant au ressenti des informations qu’ont eu les patients au sortir d’une consultation, que ce soit pour le médecin généraliste ou pour le médecin spécialiste. Nous sommes le pays où les patients se sentent le moins impliqués dans les décisions.
Cela ne veut pas dire que ce soit totalement fondé, mais c’est le ressenti des patients et il est important d’en tenir compte. D’autres enquêtes ont montré, dans le même état de choses, la divergence de perceptions. Notamment une enquête réalisée en 2011, par l’INPES, sur le diabète, où l’on voit les différences de perception qu’il y a dans la décision qui a pu être prise, entre le patient et le médecin : dans près de 60 % des cas, le patient a clairement l’impression que c’est le médecin qui a pris la décision, alors que le médecin a eu l’impression de ne prendre la décision que dans 20 % des cas à peu près, de la partager dans les autres cas et dans
près de 25 % des cas que c’est la décision du patient.
On voit bien qu’il y a un problème de ressenti qui mérite d’être explicité, c’est un problème sur lequel il faut absolument travailler. Je voulais également vous montrer l’étude faite par Bouhnik[3] qui montrait, que dans le cadre du cancer, 25 % des patients impliqués ne souhaitaient pas être informés du diagnostic. C’est à prendre en compte. En pratique, pour arriver à ancrer cette culture de la décision partagée, qui manifestement dans le modèle de soin français, n’est pas encore complètement acquise par les professionnels, en particulier par le médecin, il faut d’abord développer des recommandations, parce que l’on ne peut partager une décision qu’à partir du moment où il existe de la base documentaire et des preuves. Sinon, on est dans l’opinion. On est dans le cadre de beaucoup de médecines alternatives, par exemple, où l’on pense faire sans preuve. C’est l’effet placebo. Cela peut être efficace mais on n’est pas dans le même registre. Pour produire des aides à la décision, il faut avoir des supports. On ne peut pas demander à chaque professionnel de faire lui-même ses supports. Il faut aider à faire les supports, cela nécessite une organisation spécifique. On ne peut pas travailler de la même manière. Les temps de consultation ne sont pas les mêmes.
Et puis il faut mettre en place, auprès des professionnels, des programmes d’amélioration de la qualité et de la sécurité, des programmes de formation, d’analyses des pratiques professionnelles et de gestion du risque. Tout cela doit être fait, bien sûr, avec les patients.
En conclusion, la décision partagée nous paraît être le point ultime de l’information. On commence par informer et après on partage les décisions. Quand on met en place ces méthodes, toutes les études montrent que l’on améliore cette participation du patient. C’est un point unanime dans toutes les études montrant que l’on peut réellement arriver à partager les décisions, on constate des résultats authentiquement meilleurs, en sachant que, chaque fois, c’est multifactoriel. Il est extrêmement difficile de démontrer que c’est uniquement cette partie-là qui est améliorée.
Mais pour autant, en termes de qualité et de sécurité des soins, en termes d’observance des thérapeutiques, en termes d’iatrogénie et de prévention des risques, et en termes de mieux-être, de bien-être et de baisse de l’anxiété, c’est efficace et cela mérite d’être mis en place.
Cela a permis aussi une meilleure efficience, même si les résultats des analyses ne sont pas significatifs.
Enfin, cela permet d’éviter beaucoup de litiges, ce qui est important pour les patients comme pour les professionnels, parce que c’est une cause de nuisance et d’anxiété extrême. Sachez qu’en France, la moitié des litiges qui ont lieu en interventionnel, c’est-à-dire chirurgie et autres, sont dus à un défaut de communication, à un défaut de partage de l’information, à un défaut de décision partagée entre les professionnels et leurs patients.
[1] http://www.scopesante.fr/#/
[2] Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé.
[3] Bouhnik A. B., MOUMJID N., PROTIÈRE C., « L’implication des patients dans le choix des traitements », in La vie deux ans après le diagnostic de cancer, La Documentation française, 2008, 123-136.
RETOUR EN HAUT DE PAGE
voir tous les articles de la catégorie